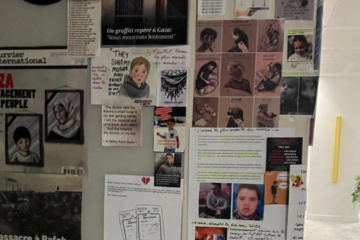Frédéric Potier fait le bilan de son mandat à la Dilcrah auprès du ToI

-
Frédéric Potier, Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) depuis mai 2017, a quitté ses fonctions le 12 février dernier. Sophie Elizéon, préfète de l’Aude, lui succédera à partir de la semaine prochaine.
Diplômé de l’ENA et de l’Institut d’études politiques de Bordeaux, Frédéric Potier a rejoint le groupe RATP, où il a été nommé Délégué général à l’éthique et à la conformité. Il s’occupera des questions relatives à l’éthique, à la laïcité, à la diversité, à l’égalité hommes-femmes, aux violences sexuelles et aux discriminations.
Il a publié ces dernières années plusieurs ouvrages, dont La matrice de la haine (2020) et Contre le racisme et l’antisémitisme (2019).
Après plusieurs entretiens au Times of Israël durant son mandat à la DILCRAH, Frédéric Potier nous a accordé mi-février une interview bilan, juste avant sa prise de poste à la RATP.
The Times of Israël : Quel bilan dressez-vous de votre mandat et de la situation aujourd’hui en France, en particulier en ce qui concerne l’antisémitisme ?
Frédéric Potier : Il y a eu une baisse des actes et des menaces antisémites sur l’année 2020 – ce qui est surtout le résultat des périodes de confinement. Ce qui ne veut bien sûr pas dire que l’antisémitisme a disparu en France, mais simplement que sa manifestation – en tout cas pour l’année 2020 qui a été très atypique – en a été altérée.
Je pense qu’on peut tirer un bilan positif à la DILCRAH sur les outils, les dispositifs, les actions, en particulier pour ce qui est formation, lutte à travers l’éducation, lutte avec les lieux de mémoire… On a aussi fait beaucoup de choses sur Internet.
Mais il faut évidemment toujours garder une grande vigilance, car l’antisémitisme comme le racisme et l’homophobie ne disparaissent pas comme ça. Il n’y a pas de recette miracle ou de baguette magique. L’action reste toujours à renouveler, à réinventer, à requestionner… L’antisémitisme se réincarne souvent dans de nouvelles expressions. C’est un combat face auquel il ne faut jamais abdiquer.
En 2019, vous déclariez au Times of Israël : « Il faut trouver les mesures opérationnelles, les actions, pour faire reculer l’antisémitisme. » Estimez-vous avoir trouvé en partie ces mesures ? Quelles actions concrètes a entrepris la DILCRAH dans la lutte contre l’antisémitisme ?
Si je prends un peu de recul sur ces quatre dernières années, je pense que, quand j’ai pris mes fonctions en 2017, j’étais peut-être le seul à dire qu’il fallait absolument modifier la loi, que la haine sur Internet était quelque chose de très présent et qu’on ne pouvait pas en rester à la législation actuelle.
 La députée LREM Laetitia Avia en 2017. (Crédit : Wikimedia)
La députée LREM Laetitia Avia en 2017. (Crédit : Wikimedia)J’estime que ce constat – que je faisais en mai 2017 – est depuis assez largement partagé, et je pense qu’aujourd’hui tout le monde reconnait qu’on doit modifier nos instruments juridiques – et qu’il ne s’agit pas seulement de désigner quelques magistrats supplémentaires.
Cette question de la modération et de la transparence des réseaux sociaux s’est beaucoup posée. Nous avons beaucoup milité pour l’adoption de la loi Avia, qui a depuis été largement censurée [par le Conseil constitutionnel], mais le débat s’est aujourd’hui déplacé au niveau européen. Il y a désormais des discussions au niveau des 27 États sur l’impulsion de la Commission européenne, et j’ai bon espoir que ce texte européen, qui sera commun à tous les États de l’Union européenne, viendra combler des dispositifs qui sont aujourd’hui lacunaires.
Le texte européen sera sans doute différent de ce qui a été pensé par Laetitia Avia et les députés, mais l’esprit sera le même. L’idée est que les réseaux sociaux sont des outils formidables, mais qu’ils créent aussi beaucoup d’externalités négatives, et qu’on ne peut pas uniquement s’en remettre au pouvoir public pour corriger les expressions de haine qui naissent sur ces réseaux sociaux.
Je pense que, sur ces quatre ans, on a beaucoup progressé sur la prise de conscience. Je pense aussi qu’il y a beaucoup d’acteurs associatifs qui se sont renouvelés, notamment en créant et en animant des comptes [sur les réseaux sociaux], comme par exemple les lieux de mémoire – le Mémorial de la Shoah en particulier, le Musée d’art et d’histoire du judaïsme, la LICRA, SOS Racisme… Tout cet écosystème a su se renouveler, et il y a aussi des nouveaux acteurs, comme l’Observatoire du conspirationnisme avec Rudy Reichstadt et Tristan Mendès France. En 2017, ils étaient très marginaux. Ils ont aujourd’hui pris une vraie place, parce qu’on voit un problème de ce côté-là, et qu’il est nécessaire de le résoudre.
Saluez-vous le blocage du compte de Donald Trump et de ceux de la mouvance QAnon et autres, ou cela peut-il représenter un problème pour la liberté d’expression ?
Une capture d’écran du compte Twitter du président américain Donald Trump avec deux publications bloquées par Twitter, le 6 décembre 2021. (Capture d’écran)Oui et oui. Je considère que même Donald Trump doit respecter les lois, et il n’y a pas de raison que quelqu’un qui incite à la haine et à la violence ne fasse pas l’objet de modération.
Mais à l’évidence, cela pose aussi un problème de transparence démocratique, puisqu’on a par conséquent des plateformes qui obéissent à leurs propres lignes directrices – et ça pose le problème du contrôle démocratique.
Il ne faut pas qu’il y ait d’impunité, et il faut qu’il y ait aussi une forme d’égalité. Il n’y a pas de raison qu’un militant qui lutte contre l’antisémitisme se fasse censurer parce qu’il dénonce un certain nombre de dessins ou de pratiques, et que, d’un autre côté, des gouvernants en soient exemptés [de la modération] parce qu’ils sont gouvernants. Cela pose bien ces questions de transparence, de modération, et je pense qu’on a beaucoup progressé sur ces questions-là.
L’antisémitisme s’est-il « décomplexé », est-il devenu « ordinaire » ces dernières années – dans l’espace public mais aussi sur les réseaux sociaux avec des hashtags antisémites régulièrement en tête des tendances (« #sijetaitunjuif », « #JewishPrivilege », « #UnBonJuif »), ou avec les récentes insultes visant Miss Provence ?
Cet antisémitisme était déjà présent. Ce qu’on a pu appeler le « nouvel antisémitisme » n’est pas une découverte. C’est quelque chose qui prend aujourd’hui un essor très important sur les réseaux sociaux. Et je n’ai donc pas été particulièrement surpris.
Cela montre que ce n’est pas une question de GAFAM américains, mais une question d’opérateurs et de gestion de leurs propres modèles de diffusion. C’est une question de volonté, d’engagement financier. Des acteurs considèrent nécessaires d’avoir des discussions et des collaborations avec des pouvoirs publics ; d’autres acteurs considèrent que, tant qu’il n’y pas de loi, ils n’auront pas besoin de faire grand chose. J’en reviens à la nécessité de légiférer.Ça appelle aussi à la responsabilité d’une plate-forme comme Twitter, qui n’est aujourd’hui pas à la hauteur de ses obligations. D’autres acteurs ont fait beaucoup de choses : Facebook a engagé de nombreux modérateurs, informe, a mis en place un fonds d’un million d’euros… Twitter n’en est pas du tout là.
Quel est selon vous le principal danger pour les Juifs aujourd’hui en France : l’islamisme ? La haine anti-Israël qui pousse à des crimes antisémites ? Ou le vieil antisémitisme traditionnel d’extrême
droite ?Ces trois sources existent à l’évidence. L’islamisme est évidemment lié à l’antisémitisme. La haine d’Israël et l’anti-sionisme sont également des vecteurs importants de l’antisémitisme que nous avons cherché à combattre, en particulier avec la définition de l’IHRA qu’on utilise dans nos formations et avec la résolution qu’on a aidé à faire adopter à l’Assemblée nationale. Et il y a aussi cet antisémitisme très classique qu’on trouve à l’extrême droite.
Mais ces schémas-là sont peut-être un peu intellectuels, car ces trois sources se mélangent parfois. Ces schémas qui peuvent paraitre intellectuellement assez ordonnés peuvent se brouiller complètement dans l’esprit de personnes un peu détraquées.
Je pense donc que, sur la question de l’antisémitisme, il n’y a que des combats à mener, et que la question n’est pas uniquement celle de la source, mais aussi celle de l’émetteur ou de l’expression et la façon de contrer ces messages.
Pouvez-vous revenir davantage sur votre travail pour l’adoption de la définition de l’antisémitisme de l’IHRA, qui lie en quelque sorte les attaques anti-Israël à l’antisémitisme ?
La France a voté pour cette définition en 2016. Il était donc important que l’État assume cette position et la décline. C’est pour cette raison que le président de la République a indiqué qu’il endossait cette définition en février 2019.
Nous avons mené à partir de là un certain nombre de formations – pour les policiers, les magistrats –, pour expliquer ce dont il s’agissait. On a aussi réalisé des documents pédagogiques, notamment à destination des enseignants, pour expliquer que l’anti-sionisme était aussi une forme d’antisémitisme.
Cette question-là n’est pas forcément simple : il y a des questions de définition, de compréhension… Mais je pense que l’État français a adopté une grande clarté sur ce sujet.
 Le préfet Frédéric Potier de la DILCRAH en octobre 2017. (Crédit : DILCRAH)
Le préfet Frédéric Potier de la DILCRAH en octobre 2017. (Crédit : DILCRAH)Quel est l’impact de la pandémie sur la montée des haines ?
Il est direct. Cette période de crispation, de tensions, d’inquiétudes, génère évidemment des logiques de bouc-émissaires. On voit bien que, sur Internet et les réseaux sociaux, certains entrepreneurs de haine n’hésitent pas à désigner certains groupes religieux, ethniques ou sociaux comme la source de cette pandémie.
On a vu ressurgir – même si elles n’avaient pas disparu – des idées racistes, notamment contre les personnes d’origine asiatique au début de la pandémie ; et complotistes, avec des théories sur l’idée d’un grand complot mondial, le complot juif et franc-maçon…
Je n’ai pas été particulièrement surpris. On a fait des signalements judiciaires quand il s’agissait de propos haineux. Évidemment, ce contexte sanitaire compliqué à gérer suscite des phénomènes de rejet et de refus de l’altérité et il faut en être conscient.
Dans certains quartiers, le départ des Juifs semble être depuis ces dernières années une nécessité et la seule solution contre l’antisémitisme. Certains parlent de zones « de non-droit », de zones de « non-France », des zones « perdues de la République ». Quelle est votre analyse ? Et de façon plus générale, quelle place ont encore les Juifs aujourd’hui en France ?
Je n’aime pas le terme de « territoire perdu » car on a l’impression qu’il y a des no man’s land et que les règles de droit ne s’y appliquent absolument pas. Je pense plutôt qu’il y a des territoires où il y a des angles morts. Des zones où le service public ne joue plus trop son rôle et où il y a un désinvestissement. Je pense qu’il est important qu’on réinvestisse ces territoires et que l’État y soit présent, qu’il joue son rôle.
Pour ce qui est des recompositions géographiques, c’est une question compliquée. Oui il y a de l’antisémitisme, et oui l’antisémitisme peut expliquer ces recompositions géographiques, mais il y a aussi des questions de paupérisation.
Le fait que des classes sociales dites moyennes quittent certaines zones de banlieue n’est pas uniquement lié à l’antisémitisme. C’est un phénomène qui concerne aussi des Français d’autres religions. Les choses sont plus mêlées qu’on ne le croit. D’autres questions sont aussi à prendre en compte, notamment celle de l’éducation : le secteur privé juif est de très bonne qualité [d’où une possible volonté de déménager pour l’intégrer]. Il y a aussi le choix de l’alyah, qui peut être religieux. Tous ces phénomènes se mélangent et sont compliqués à démêler, mais à l’évidence il y a des zones où il y a un antisémitisme très enraciné.
La pensée dite « islamo-gauchiste », « anti-impérialiste » ou « décoloniale » et son émergence au sein de l’université ont beaucoup fait parler ces dernières semaines. Quel danger représente cette mouvance ?
C’est là aussi un phénomène qui recoupe plusieurs réalités. Je dirais tout d’abord que les chercheurs et les universitaires sont libres – et c’est très important. Libres de mener leurs recherches, de penser… Mais de la même façon, le public est libre de s’inspirer de leurs théories, de leurs travaux, ou de les faire travailler.
Le Conseil scientifique de la DILCRAH, présidé par le sociologue Smaïn Laacher, réunit des historiens comme Iannis Roder ou Emmanuel Debono et des gens qui vont plutôt travailler sur des questions de migration ou de mémoire de l’esclavage. Je pense qu’on peut d’évidence considérer que la colonisation a une influence sur notre société actuelle. J’ai beaucoup travaillé sur les territoires d’outre-mer – et notamment la Martinique et la Guadeloupe –, et si on ne comprend pas la mémoire de l’esclavage ou son histoire, on ne comprend rien à ces territoires. La colonisation a eu un effet dans nos mentalités et dans nos représentations, et c’est ce que dit Benjamin Stora dans son dernier rapport. Pour autant je pense que cela n’explique pas tout. Il n’y a pas, à partir de ces théories, à avoir une vision du monde dans laquelle il y aurait d’un côté les dominants et de l’autre les dominés, d’un côté les racisés et ceux qui ne le seraient pas.
Ce que je trouve extrêmement dangereux dans certaines théories, c’est cette idée qu’il y aurait une essentialisation, qu’on mette une étiquette : « Vous êtes de telle religion, vous êtes Blanc, non Blanc. » Je pense que les identités sont complexes, multiples, et je pense qu’un des grands apports de la Révolution française, des Lumières et de l’universalisme, c’est qu’au fond les identités se mélangent et les individus sont libres.
Je pense que, sur certaines pseudo-théories sociologiques, il y a une forme d’enfermement identitaire et victimaire qui est extrêmement dangereuse. Je ne veux pas généraliser, mais s’il y a un combat intellectuel à mener, il faut y aller de front, que les chercheurs, les historiens et les citoyens s’engagent. Et beaucoup le font : il y a notamment le réseau ALARMER qui a été créé.
Mais c’est la vie intellectuelle du pays : il y a 40 ou 60 ans, il y avait de grands débats sur le maoïsme ou le marxisme. Aujourd’hui, il y a d’autres effets de mode.
Vous avez cité sur Twitter le proverbe africain « Seul, on va plus vite mais ensemble on va plus loin ». Quels ont été vos rapports avec les représentants et responsables communautaires et associatifs juifs ces dernières années ? Noémie Madar de l’UEJF, Ariel Goldmann du FSJU et Philippe Meyer du B’nai B’rith ont salué votre action.
Nous avons eu des rapports de grande franchise et de grande confiance. Ils n’ont pas hésité à me dire quand ils s’estimaient insatisfaits de l’action publique. Et j’ai essayé de créer avec eux des collaborations efficaces quand j’estimais qu’il fallait qu’on puisse travailler ensemble sur certains sujets. On a réfléchi ensemble : personne ne prétend avoir de solution toute prête pour lutter contre l’antisémitisme. Outre l’UEJF et le B’nai B’rith, nous avons travaillé avec le CRIF, le Consistoire, le grand rabbin de France, avec les mouvements libéraux… J’ai toujours essayé de ne pas être uniquement dans le discours et l’incantation morale, mais plutôt dans l’action très concrète. Donc ma porte a toujours été ouverte aux propositions et aux initiatives pour essayer de faire changer les choses. Et cela va continuer, je n’en doute pas.
Vous vous êtes rendu en Israël en 2018. Quelles images et quels souvenirs gardez-vous de ce voyage et de ce pays ?
Je ne connaissais pas Israël avant de prendre mes fonctions à la DILCRAH. J’ai d’abord été conquis par les Israéliens avec lesquels j’ai eu des échanges de très grande qualité. J’ai eu la chance d’être reçu par le président Reuven Rivlin et d’accompagner le président Emmanuel Macron lors de sa visite officielle en début 2020.
Je pense que Français et Israéliens ont beaucoup de choses et de valeurs en commun. Trouver la façon d’exprimer cela est importante. Comme il est important également de ne pas cacher des inquiétudes qui peuvent être réciproques, et d’être dans l’action. C’est ainsi qu’on travaille le mieux.
Un dernier mot ?
Shalom !